

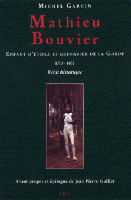 |
MATHIEU BOUVIER, enfant d'Étoile et grenadier de la Garde. 1773-1832. Michel Garcin, préface de J.-P. Guillet. 16 x 24 cm. 512 pages. Couverture pelliculée en couleurs. Papier bouffant ivoire 90 grammes. 2 cahiers de 16 pages de photographies en noir et blanc et de documents historiques.Gravures dans le texte. 145 FF. L'histoire incroyable d'un Drômois qui suivra l'aventure napoléonienne jusqu'à l'exil. Ce roman historique s'inspire de faits réels, et c'est un descendant de ce soldat qui réunira pendant 20 ans les pièces qui ont permis d'écrire ce livre ! |
(Membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, Professeur à la Sorbonne, Directeur d'Études à l'École Pratique des Hautes Études. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, École pratique des Hautes Études, IVe section, Sciences historiques et philologiques à la Sorbonne.
Bravo ! Il s'agit d'un livre d'une exceptionnelle richesse.
Pensez au Grand Prix du Souvenir Napoléonien (adresser un exemplaire 82, rue de Monceau, 75008 Paris).
Et encore merci.
J.T.
Extrait de la préface de Jean-Pierre Guillet :
Aux habitants d’Étoile et de Montéléger qui retrouveront leurs aïeux au hasard des pages de ce livre. Qu’ils sachent aussi que c’est chez eux que j’ai gravé mes plus inoubliables souvenirs.
AVANT-PROPOS
Mon grand-père décida lorsque mon père revint de captivité en 1941 de nous envoyer tous attendre des jours meilleurs dans la maison d’été que nous possédions dans la Drôme, à Montéléger, petit village situé au sud de Valence. Mon arrière-grand-père y avait une propriété agricole et avait fait édifier, dans les années 1870, une belle construction qu’on appelait alors une « maison de maître ». C’est là, qu’un après-midi, le taxi Signoret, venant de Carpentras où nous habitions, nous déposa pour at-tendre la fin de la guerre.
Je n’avais pas trois ans. La demeure, bien que belle et grande, n’était pas aussi confortable que celle de Carpentras. Il n’y avait pas d’eau courante et pas d’électricité. Mis à part ces deux éléments essentiels, c’était tout le charme de la maison de campagne. Au rez-de-chaussée, un grand salon tapissé de tableaux et rempli de vieux meubles, une salle à manger impressionnante par sa rigueur, la chambre de mon arrière-grand-père, et diverses autres pièces dont la cuisine. Côté cour, un très grand potager avec la pompe à eau surmontée d’une éolienne, des remises et un verger de cerisiers superbes. Côté jardin, un joli parc planté de taillis et d’arbres majestueux. Au premier étage, des chambres, et au-dessus des greniers.
Mon arrière-grand-père était né à Valence en 1848. Il avait épousé Valentine Deloche, fille de Jean-Pascal et de Sophie Lérisse, qui vivait à Étoile, village voisin de Montéléger. Sophie Lérisse était la nièce de Marie Lérisse, épouse de Mathieu Bouvier, le héros de ce livre. Mon arrière-grand-père, Charles Guillet, était fonctionnaire dans l’administration des impôts. Il avait fait toute sa carrière à Valence et au Creusot. Vers 1900, il prit sa retraite et vint habiter définitivement à Montéléger jusqu’en 1926, date de sa mort. Mon grand-père Jules Guillet, avoué à Carpentras, hérita de la propriété qu’il transforma en maison d’été.
J’ai un souvenir assez précis de ce vaste logis aux allures de gentil-hommière, bien que l’ayant quitté pour toujours après les vacances de 1947. Pour toujours, parce que mon grand-père, devant la désaffection de la famille pour une demeure aussi lointaine, la vendit en 1948. Il conser-va seulement la ferme et les terres de labour.
Sans électricité, mais avec des bougies et des lampes à pétrole, nous y avons vécu au rythme de la campagne. Un rythme lent et mesuré qui ne manque point de vous communiquer une certaine mélancolie. Les grandes maisons silencieuses vous ressassent sans cesse leurs souvenirs et j’ai encore en mémoire les longs moments que je passais à contempler les vieux livres de la bibliothèque, les vieux personnages dans leurs vieux cadres dorés et, encore aujourd’hui, je traîne ces restes de mélancolie.
En 1948, la maison de Carpentras était sens dessus dessous : beau-coup de meubles sur les paliers, dans les vestibules, dans les greniers. Tous ces objets, m’expliqua-t-on, provenaient de la propriété de Monté-léger que mon bon-papa venait de vendre. J’avais neuf ans et je fus triste.
Vers les années 1955, habitant alors Marseille, je passais chaque été quelques semaines de vacances dans la maison familiale de Carpentras. Mon grand-père était mort, et ma tante Simonne, sa fille, vivait seule avec ma grand-mère dans cette grande habitation. Ma tante Simonne aimait à me promener à l’intérieur de toutes les pièces et me parlait de nos chers disparus. À nouveau, je baignais dans le passé, et ainsi une grande partie de mon enfance puis de mon adolescence fut consacrée à l’évocation des mes aïeux. Ce fut à ce moment-là que j’ai vraiment découvert l’existence de Mathieu Bouvier.
Une année, intrigué par un vieux papier jauni portant son nom et par une médaille, je demandai : « Qui est-ce ? », on me répondit : « C’est le grand-père… », et c’était là, invariablement, le seul renseignement qu’on me donnait quand je renouvelais ma question. Personne, à vrai dire, ne savait au juste qui était Mathieu Bouvier. Ses souvenirs étaient dans la famille depuis plusieurs générations. D’héritage en héritage, on les con-servait sans connaître le lien qui les rattachait à nous.
Aux vacances suivantes, je découvris un sabre, des verres aux chiffres de Napoléon et de Marie-Louise, des livres de manœuvres militaires, des tasses et toutes sortes d’objet du 1° Empire. Encore plus tard, je mis au jour, dans une caisse en bois, de vieux documents, des dossiers, des lettres, et, ce jour-là, je décidai de percer le mystère Mathieu Bouvier.
Avec quelque maladresse, je commençai un arbre généalogique. Les papiers contenus dans la caisse en bois me furent d’une grande utilité et, assez rapidement, je reconstituai l’ascendance des Guillet jusqu’en 1760. Consciencieusement, j’entrepris le même travail pour les épouses Guillet, lorsque je tombai sur un acte de mariage d’une Marie Lérisse avec un Mathieu Bouvier, ancien militaire et chevalier de la légion d’honneur. Mon père avait prononcé devant moi, en regardant de vieilles photos, le nom de Lérisse. Comme il me fallait trouver le lien entre Lérisse et Guillet, il m’apprit aussi que son arrière-grand-mère Sophie était une demoiselle Lérisse. Je découvris vite que l’épouse de Mathieu Bouvier n’était autre que la tante de Sophie Lérisse.
Quelques mois plus tard, je terminai l’arbre généalogique. Mathieu Bouvier avait donc épousé à Étoile, le 22 octobre 1814, Marie Lérisse, arrière-arrière-grand-tante de mon père. Grâce à son diplôme de Légion-naire, j’obtins du Service Historique de l’Armée de Terre, à Vincennes, la photocopie de son dossier militaire.
Fascination. Engagé en octobre 1791 dans le 3° Bataillon des Volon-taires de la Drôme, après plusieurs années passées dans la 18° demi-brigade de ligne, il devint grenadier de la Garde des Consuls en 1802 — transformée en Garde Impériale en 1804 — fit les campagnes d’Espagne, d’Italie, de Suisse, d’Égypte et de Syrie. Pendant l’Empire, il traversa l’Europe en tous sens : campagnes d’Autriche, de Prusse, de Pologne, de France. Il reçut la Légion d’honneur en 1813, et fut congédié de l’armée le 30 juin 1814.
Fascination, disais-je. Le mot est faible. À partir de ce jour, je ne rê-vais plus que de retracer sa vie au travers des régiments dans lesquels il avait servi, et dont le principal était le 1° Régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale. Je rassemblais la documentation nécessaire à cette épopée. Je lisais, je notais. Le récit était dans ma tête, mais l’écrire était une autre affaire ! J’avais parlé de mon intention à Monsieur Rambert George, un homme dévoué à l’histoire de la Drôme. Celui-ci me fit part de la parution d’un livre de Michel Garcin sur les bataillons de volontai-res et les généraux drômois de la Révolution et de l’Empire. Michel Garcin habitait Bourg-de-Péage ; son livre, « La patrie en danger », me pas-sionna et allait m’être d’une grande utilité pour mon récit.
Avec l’histoire de Mathieu Bouvier, je n’abordais pas le genre le plus facile. En effet, il fallait avoir à la fois les connaissances d’un historien et la plume d’un romancier. La tâche devenait trop difficile pour moi et mon projet fut remis.
Quelque temps après, je pris contact avec Michel Garcin. Nous nous sommes rencontrés à Sablet. Je lui contai mon histoire.
— Voulez-vous l’écrire ? lui demandais-je.
Quelques jours passèrent. Il me dit bien vouloir essayer. Sa décision sauvait Mathieu Bouvier de l’oubli.
De rendez-vous en rendez-vous, d’entretiens en entretiens je lui communiquai ce que je savais. Je lui confiai mes archives et le talent de Michel Garcin a fait le reste.
L’an mille sept cent soixante-treize, en Dauphiné, fut fort calamiteux pour tous ceux qui le vécurent, ou plutôt en subirent les désolants caprices. Le vent du sud, pendant des semaines, assécha les sources et les rus, brûla les pâturages, déracina les jeunes noyers, puis la grêle hacha les vignes et des pluies incessantes, succédant à ces déplorables fléaux, noyèrent les cultures que des gelées précoces avaient déjà affaiblies.
Les blés pourrirent sur place avant que d’être moissonnés et les grains se vendirent bientôt au prix jamais atteint de quinze livres dix sols le setier. Les rigueurs du climat et les privations de toutes sortes, conjuguées aux fièvres putrides qui s’élevaient des champs gorgés d’eau et transformés en marais, arrachèrent à la vie nombre de vieillards et d’enfants.
J’eus une certaine chance, en vérité, d’échapper à la mort, car ce fut à la fin de cette affligeante année, le 15 décembre très exactement, que j’ouvris pour la première fois les yeux sur le monde, à Étoile, gros bourg de deux mille trois cents âmes situé à trois ou quatre lieues de Valence.
Ma mère, Magdeleine Rochas, était unie par les liens du mariage à Mathieu Bouvier, maître cordonnier qui tenait son échoppe dans la rue principale du village, près de la Fontaine Couverte. Quoique très affaiblie par des couches qui ne s’étaient point passées sans souffrances, elle eut un grand cri de bonheur quand l’une des femmes assistant à cet insigne événement et accoucheuse de son état, me présenta à elle tout gigotant dans mes linges souillés.
– Mon Dieu, pourvu qu’il vive au moins celui-là ! murmura-t-elle après m’avoir longuement contemplé.
Il est vrai qu’elle avait donné le jour, trois ans auparavant, à une fille, Marie, qu’on avait mise en terre moins d’une semaine après sa naissance. Depuis, elle attendait avec espoir que le ciel — et son époux — lui accordassent la joie d’un nouvel enfant qu’elle pût aimer et voir grandir auprès d’elle.
Je ne sais si l’Être Suprême qu’elle invoquait pour ma sauvegarde répondit à sa prière ou si je ne dus de survivre qu’à ma seule constitution, mais toujours fut-il que j’évitai comme par miracle tous les dangers mortels de la prime jeunesse tels que rougeole, étouffement, fièvre maligne, et principalement petite vérole — « fléau destructeur de l’espèce humaine ».
Mon père disait souvent à qui voulait l’entendre que j’étais cuirassé contre le mal pour être sorti du ventre de ma mère au plus fort d’une tempête de neige, comme il n’y en avait pas eu à Étoile depuis des lustres, et que cette circonstance mémorable était pour moi le signe avant-coureur d’une solide complexion et d’une existence aventureuse.
Malgré la neige qui avait gelé sur le pavé pendant la nuit, et le froid extrême qui suspendait aux lucarnes des aiguilles de glace, je fus conduit dès le lendemain de ma naissance devant le curé du village, dans l’église paroissiale dédiée sous le vocable de Notre-Dame. J’y reçus le baptême sous le nom de Mathieu, ainsi qu’il est d’usage dans les familles du Dauphiné d’attribuer souvent au premier fils le saint patron du père.
L’eau bénite versée sur mon front eut pour principal effet de me réveiller d’une torpeur inquiétante et j’emplis paraît-il la nef du sanctuaire de glapissements indignés qui prouvaient — s’il en était besoin — que j’étais bien vivant et prêt à affronter les périls, les pièges ou les misères du temps.
Car, pour les pauvres gens que nous étions, mes parents et moi — parmi tant d’autres aussi mal lotis que nous ! — rien n’était facile, tout n’était prétexte qu’à une lutte continuelle, rude, impitoyable, et les moments de félicité ou de joie n’étaient que de rares intermèdes survenant au plus fort des jours besogneux consacrés à la subsistance.
Certes, nous n’étions pas, toutefois, des indigents, et il y avait à Étoile nombre de malheureux beaucoup plus à plaindre que nous, tels que manœuvriers, travailleurs de terre, journaliers à la petite semaine, infirmes, vieillards sans ressources, mendiants, vagabonds errant comme des chiens perdus dans les rues du village. Mais, malgré que mon père fût reconnu comme l’un des plus habiles et des plus estimés cordonniers parmi les dix ou douze de cette honorable corporation établis dans notre communauté, et que l’ouvrage ne lui manquât point, il n’y avait jamais rien de trop dans notre escarcelle pour faire bombance.
Nous possédions heureusement un jardinet, au quartier de la Sauze, où nous cultivions quelques légumes au pied de deux maigres pommiers, et une petite chènevière qui donnait, bon an mal an, de quoi tisser nos bliauds, nos chemises et les casaquins de ma mère.
Celle-ci tirait parti de tout et avait la sagesse d’épargner les réserves de « truffes », choux, haricots, pois, raves, noix, qu’elle amassait dans notre cellier, en prévision de la disette. Nous nous moquions parfois de ses manies parcimonieuses mais, au plus fort du terrible hiver de 1788 qui vit les pauvres se nourrir d’herbe hachée, nous dûmes à sa prévoyance d’éviter les affres de la famine et nous nous louâmes de sa modération.
Les dimanches et jours chômés, elle n’avait pas son pareil pour améliorer l’ordinaire, et elle nous régalait de succulentes soupes de crozets, de truffades ou de matefaims épais comme le doigt. Parfois, quand on avait la chance d’avoir une langue de bœuf, un cervelas ou du jarret de porc, elle nous apprêtait quelque potée bien grasse et bien onctueuse que nous savourions avec gourmandise, comme si nous eussions dévoré un mets royal. Et, pour les principales fêtes religieuses, nous nous disputions, mes deux frères et moi (Louis était né en 1777 et Joseph en 1781) les tourtons dorés et croustillants qu’elle faisait rissoler au-dessus du feu dans sa grande poêle noire.
En contrepartie, tout au long de la semaine, nous nous contentions de simples soupes de gruau avec du pain d’épeautre trempé ou d’herbes potagères agrémentées d’un peu de lard salé.
Quoique ce ne fussent point des repas de prince, ni même de bourgeois, nous ne sortions jamais de table avec la faim au ventre, ce qui était fort utile, après tout, pour que nous accomplissions sans faiblesse les rudes et nombreuses tâches quotidiennes.
Mes parents étaient debout bien avant l’aube. Pendant que ma mère réactivait le feu assoupi pendant la nuit, mon père pénétrait dans son échoppe, ouvrait le volet de l’unique fenêtre donnant sur la rue, allumait un quinquet et s’attachait sur les reins le long tablier qui lui descendait jusqu’à mi-jambe. Puis il s’entourait la paume et le dessus de la main gauche d’une manicle — morceau de cuir de veau large de deux pouces laissant les doigts libres lorsqu’on serre avec force les points de cou-ture — s’asseyait devant son écoffret et aiguisait sa paire de gros ciseaux ou ses tranchets à l’aide d’un fusil.
Commençait alors le vrai travail du cordonnier, avec le traçage et la découpe des différentes parties de la tige, la préparation de la semelle posée sur la buisse creuse et façonnée à coups de manche de marteau afin qu’elle se relève tout autour en forme de gondole, puis la fabrication des talons de bois avec un tranchet à bûcher, et l’assemblage de toutes ces pièces sur la forme en bois de fayard .
Ses gestes, dans leur simplicité, étaient d’une précision extraordinaire. Je les admirais, je les enviais, et c’était pour moi un étonnement toujours renouvelé que de lui voir bâtir une paire de souliers avec des éléments aussi disparates.
Mais, si je contemplais son ouvrage, je n’en restais pas inactif pour autant et, dès que j’eus franchi les années de la petite enfance, il m’enseigna les premiers rudiments du métier, m’apprit à battre le cuir des semelles sur un billot de grès pour le raffermir et corroyer, à me servir de la bisaiguë pour polir les talons, à préparer la cire blanche, la cire jaune, la cire à poisser le fil gros, à distinguer un carrelet d’une alène, et surtout à reconnaître un cuir de veau d’un maroquin ou un cuir de bœuf en blanc d’un cuir de vache.
Ces fournitures indispensables, nous allions les acheter deux fois l’an dans des tanneries, à Valence et Romans. Pour ce faire, mon père em-pruntait sa carriole et son mulet à l’un de nos proches voisins, Jean Lérisse, travailleur de terre, et nous partions pour une interminable journée de charroi.
Pour moi, que les hasards de la guerre, beaucoup plus tard, ont conduit partout en Europe, et même au-delà des mers en Afrique, moi qui ai foulé les sables brûlants du désert ou les grasses terres des plaines de Pologne, moi qui ai côtoyé des monuments aussi prodigieux que les Pyramides ou aussi illustres que les palais de Schönbrunn et de Fontainebleau, je n’avais à ce moment de ma vie, pour seul horizon, que les molles ondulations boisées qui entourent Étoile et, du plus loin que je regardais, je ne voyais que les falaises blanchâtres des Monts du Matin ou, de l’autre côté du Rhône, les hauteurs sombres et sévères du Vivarais.
Quand nous partions pour Romans, c’était une véritable expédition. Nous avions, en effet, une dizaine de lieues à parcourir par de mauvais chemins qui nous conduisaient à travers bois et collines jusqu’à Chabeuil, puis, traversant ensuite une vaste et riche plaine à blé, nous arrivions sur les bords de l’Isère, au Bourg de Péage de Pizançon. Après avoir franchi le pont, nous étions au cœur de Romans, mais je n’ai jamais connu de cette cité que le quartier de la Presle où prospèrent les tanneries et les mégisseries car les eaux y sont excellentes pour le travail du cuir. J’ai le souvenir très vivace des hautes maisons à balcons de bois où séchaient les peaux et de l’air empuanti que nous y respirions. Mon père ne se trompait guère dans le choix de la fourniture, qu’il jugeait de la main après l’avoir palpée et étirée de part en part. Chez Denis Royanez, Seguin ou Meynier, il était sûr de trouver les meilleures bandes de cuir brigadi et les croupons les plus fermes pour les semelles. Il en acquérait autant que le lui permettaient ses finances — ce qui n’était jamais assez ! — nous chargions les ballots sur notre carriole, et nous repartions aussitôt après avoir seulement avalé une assiettée de soupe et un morceau de fromage dans une auberge du Bourg de Péage de Pizançon où nous aurions pu coucher, mais mon père en décidait toujours autrement, pressé qu’il était de retrouver sa chère épouse, son échoppe et son foyer, et bien qu’il eût constamment la crainte d’être attaqué par des loups ou des brigands. Nous n’eûmes jamais à nous défendre des uns ou des autres, ce qui est heureux, car la méchante pétoire (avec laquelle il m’apprit toutefois à tirer sur les geais et les corbeaux) qu’il cachait sous le siège de la voiture n’eût sans doute pas suffi à nous sauvegarder !
La distance d’Étoile à Valence, trois fois moindre, était beaucoup plus à la mesure de nos capacités physiques et de nos modestes moyens de locomotion. Nous nous rendions donc plus souvent et avec plus de facilité dans l’ancienne capitale du duché de Valentinois, où d’ailleurs nous pouvions nous approvisionner en outils tranchants, en cire de bottier, en clous à monter, en fil de Bretagne et soies de sanglier, sans oublier les étoffes de serge et de droguet pour ma mère.
Une enceinte de murs crénelés, mais fort délabrés, entourait la ville que mes yeux d’enfants découvraient avec l’émerveillement respectueux éprouvé devant les grandes cités, alors qu’elle n’était qu’une simple bourgade de quelques milliers d’âmes endormie dans une semi-torpeur, mais siège néanmoins d’un Présidial, d’une Sénéchaussée et d’un Évêché. Par la porte Saunière flanquée d’une grosse tour à mâchicoulis qui n’abritait plus que les corneilles et les pigeons, nous pénétrions dans la Grande Rue. Cette artère principale était peuplée, à droite comme à gauche, d’une succession de boutiques, d’ateliers et de cabarets, où l’on rencontrait une foule disparate en quête de marchandises diverses et de beuveries.
Par cette rue, puis par celle des Boucheries, nous arrivions au pied de la citadelle bâtie sur un terre-plein assez élevé qui domine la haute et la basse ville et d’où l’on aperçoit, au-delà des toits et des murs, le large ruban scintillant du Rhône. À l’angle de cette forteresse, défendue par un bastion, nous descendions vers les quais par la côte Saint-Estève. Mon père avait à y visiter l’unique mégisserie qui lui vendît le maroquin rouge, jaune ou noir dont il avait parfois besoin.
La citadelle servait de casernement à un régiment d’artillerie, le régiment de La Fère, commandé par un colonel ayant le rang de brigadier des armées du roi. Au cours de mes « voyages » à Valence, je vis plusieurs fois des compagnies de soldats qui évoluaient en ordre serré sur les glacis des fortifications, obéissant aux ordres criés par leurs officiers.
Mon père craignait l’armée comme la peste, quoique la jugeant nécessaire, mais il laissait le soin d’y faire carrière aux miséreux sans emploi et aux gens de sac et de corde. Il avait bien eu trop peur, une fois, d’être tiré au sort, après la messe dominicale, lors de la levée à Étoile de deux hommes destinés à la milice royale ! Et, ayant échappé de peu à ce service forcé, il n’avait que mépris pour les sergents recruteurs qui battaient la campagne à la recherche de gobe-mouches sensibles à leurs perfides paroles. Alors que j’avançais en âge et que j’étais devenu un beau gaillard de cinq pieds six pouces , il ne cessa de me mettre en garde contre les promesses et les agissements trompeurs de ces enrôleurs sans feu ni lieu.
Si je l’écoutais avec toute l’attention et le respect que l’on doit à son père, je n’en éprouvais pas moins un certain trouble et une certaine envie devant les uniformes aux couleurs éclatantes, les boutons dorés des habits, les guêtres blanches, les baudriers noirs et les fusils aux longs canons étincelants. Comme tout enfant un peu batailleur — je l’étais, certes, quand il le fallait et peut-être plus qu’il n’eût été utile ! — j’étais sensible au roulement de la caisse, au son de la trompette, et à la belle ordonnance d’une troupe sous les armes, disposée en lignes pour la manœuvre. Rien, cependant, ne me disposait à abandonner mon état pour devenir l’un de ces soldats dont je jalousais la prestance, à quitter une famille aimée et le village qui m’avait vu naître, où j’avais tant de bons compagnons…
Sept ou huit d’entre eux, tous fils d’artisans, de petits boutiquiers et de travailleurs de terre, m’avaient en quelque sorte choisi comme leur chef de bande, parce que je les dépassais d’une tête. Nous n’étions pas de trop méchants garnements prêts aux méfaits les plus noirs, nous n’avions pas le mal chevillé au corps, mais nous commettions toutefois quelques me-nus forfaits — des peccadilles plutôt — comme ceux d’attacher des casseroles à la queue des chiens, de capturer des souris et de les lâcher au milieu de l’église pendant la messe, de mettre des larmuzes sous les robes des filles, de vider le lavoir communal, de dérober des melons d’eau dans les champs ou des fruits sur les arbres.
J’étais, pour ma part, grand amateur de cerises quand c’était la saison. Je savais que j’en trouverais en abondance au quartier de Basseaux, sur une terre qui était à Madame Grégoire du Colombier, près du hameau de La Paillasse, dans la plaine, à une demi-lieue d’Étoile. Madame du Colombier, qui appartenait à la meilleure société de Valence, possédait là une grosse maison de campagne où elle passait l’été en compagnie de sa fille, Caroline. Nous étions, tous les gamins du village, fort éblouis par la saine beauté de cette jeune personne et par sa mise très au-dessus du commun, lorsqu’elle venait parfois jusqu’au bourg avec sa mère pour visiter les De Fontbonne ou le comte Dupont, et je pense, sans me tromper, que nous avions pour elle les yeux de l’amour. Je n’étais pas le dernier, d’ailleurs, à lui prêter toutes les grâces et toutes les perfections, mais la modestie de nos conditions nous interdisait de l’approcher, quoiqu'elle ne fût point d’un abord arrogant.
J’eusse donné tout ce que je possédais pour avoir l’insigne faveur de lui débiter un petit compliment de ma façon ; comme je ne possédais rien en propre, je savais que mon espérance demeurerait toujours lettre morte. J’étais loin de me douter, cependant, que j’aurais un jour la complicité du destin pour la réalisation de mon souhait, mais qu’il tournerait plus en eau de boudin et à mon désavantage qu’en heureux événement !
C’était en juin 1786, après la Saint-Jean, autant qu’il m’en souvienne. J’étais allé, à mon habitude, marauder des cerises aux Basseaux, en compagnie de Claude Grand et d’Étienne Bellon. Nous avions choisi le plus bel arbre, le plus chargé en fruits mûrs et délectables, et je m’étais juché le premier, à califourchon, sur une branche maîtresse particulièrement riche pour un pillard gourmand tel que moi, lorsque j’entendis que mes deux compagnons détalaient sans demander leur reste.
– Hé ! toi, qui es-tu et que fais-tu là-haut ? Descends ! me cria une voix claire et ferme mais sans rudesse apparente.
Je sautai à terre un peu hébété, avec la peur au ventre que quelque gardien ou valet de ferme ne me mît la main au collet et ne me donnât des étrivières. Mais il n’y avait, en fait de force armée, à quelques pas de moi, que Caroline du Colombier qu’accompagnait un jeune homme en habit militaire, efflanqué et de petite taille, avec des cheveux noirs et raides, des yeux sombres au regard perçant et un visage maigre au teint olivâtre. Bien que je fusse paralysé par la crainte, je crus reconnaître sur lui l’uniforme des officiers du régiment de La Fère, bleu avec des parements rouges et de larges épaulettes dorées.
Ils se mirent à rire tous deux devant ma mine défaite, et Caroline, qui avait un rire cristallin mais éclatant, rit encore plus haut et plus longtemps que son chevalier servant, ce qui acheva de me décontenancer et me submergea de honte. J’eusse pu prendre mes jambes à mon cou et m’enfuir par où j’étais venu, en sautant la haie d’aubépines qui longe la petite rivière de la Véoure, mais j’étais si pétrifié et si abêti que je demeurai sur place sans bouger. J’étais en quelque sorte devant mon idole, mais dans une position si stupide et si humiliante que je ne savais que dire ni que faire. Toutes mes folles envies de la louanger et de paraître à ses yeux moins gueux que je n’étais, avaient fondu comme neige au soleil, et je ne parvins qu’à bredouiller mon nom quand elle me le demanda.
– Tu es plus leste à cueillir des cerises qu’à répondre à mes questions ! me dit-elle d’un ton bienveillant.
– Voilà pourquoi, lieutenant Buonaparte, ajouta-t-elle à l’intention du jeune officier qui avait tout au plus dix-huit ou dix-neuf ans, voilà pourquoi ma mère se plaint toujours de ses pauvres récoltes de cerises ! Il est vrai qu’après le passage de tels oiseaux dans nos arbres, il ne nous reste guère que la portion congrue !
Elle rit derechef, bruyamment, mais sans méchanceté aucune. J’étais rouge comme la crête d’un coq et je baissais la tête pour échapper à son regard qui était pourtant d’une douceur extrême.
– Eh bien ! lieutenant Buonaparte, reprit-elle avec la mine d’une personne qui se divertissait beaucoup de la situation, qu’allons-nous faire de cet oiseau-là, maintenant que nous l’avons pris comme au trébuchet ?
– Soyez indulgente, Mademoiselle Caroline, et laissez-le aller, répondit le jeune homme sans se départir d’une sorte de rigidité militaire qui donnait plus d’ampleur à sa petite taille. J’ai moi-même bien souvent volé des châtaignes et des olives, en Corse, lorsque j’étais enfant. Et puis, voyez-vous, j’aime aussi beaucoup les cerises ! ajouta-t-il avec un léger sourire au coin des lèvres et tout en abaissant une branche sur laquelle il cueillit un joli « floquet » de fruits rouge sang, qu’il offrit ensuite à Mademoiselle du Colombier.
J’étais à mille lieues de savoir ce qu’était cette Corse dont il avait parlé, et quoique je l’eusse écouté dans un abrutissement nébuleux, je trouvais qu’il enveloppait toutes ses phrases d’un fort accent rocailleux qui ressemblait à celui des trimardeurs piémontais s’arrêtant parfois dans notre village.
– Remercie Monsieur de Buonaparte, mon garçon, car tu dois à sa clémence de ne point connaître les foudres de ma mère ! me dit Caroline d’un air malicieux. Et reviens ici chaque fois que tu auras envie de manger des cerises : je te le permets !
Je reçus cette autorisation tout contrit et je me sentis plus morveux que jamais.
– As-tu appris à lire et à écrire ? me demanda tout à coup le jeune officier.
Je fis un signe de dénégation de la tête.
– Dommage, car tu es assez grand et assez fort pour être un beau ser-gent de grenadiers !
« Je suis, en tout cas, plus grand que tu n’es toi-même ! » pensai-je avec un sentiment de révolte, mais sans avoir la force de jouer soudain les bravaches. Et, pendant que je ressassais mon humiliation, atterré d’avoir été pris la main dans le sac comme un vulgaire maraudeur et de ne montrer rien de mieux que mon ignorance, je remarquai que la belle Caroline avait tourné les talons sans m’accorder d’autre intérêt et qu’elle s’éloignait au bras du petit lieutenant.
Il va sans dire que quoique fils de cordonnier j’avais assez de fierté pour ne pas profiter d’une permission que je considérais comme une aumône, et je ne remis jamais les pieds dans le verger de Madame du Colombier, me préservant par ailleurs d’une rencontre avec sa fille, dont j’étais guéri…
Quant au lieutenant Buonaparte, je le revis plus tard sous des cieux moins cléments et dans des circonstances encore moins ordinaires, mais ceci est une autre histoire que je conterai en son temps !
* Mon père et ma mère, comme la quasi totalité de leurs congénères, étaient illettrés. Il n’y avait, à Étoile, parmi la population, qu’une minori-té de gens ayant une certaine instruction, tels que les nobles, les religieux, les échevins, les notables, et quelques dizaines de marchands ou d’artisans.
Le curé Chaix dirigeait un semblant d’école où n’allaient guère que les enfants des mieux lotis. Les plus fortunés étaient même en pension à Valence, Romans, Crest ou Grenoble, afin qu’on leur dispensât des leçons moins rudimentaires que celles du prêtre.
Les fils de besogneux, comme moi, qui aidaient leurs proches, qui apprenaient le métier du père, qui avaient aussi à accomplir toutes sortes de travaux de l’agriculture, n’étaient que peu souvent en mesure de se mêler aux élèves en train d’étudier l’alphabet et l’art de tracer les lettres avec une plume d’oie bien taillée.
Il faut ajouter qu’ils n’avaient aussi que répugnance pour cet enseignement rébarbatif et qu’ils préféraient de beaucoup aux heures passées sous la férule du maître les moments de liberté en pleine nature, à pêcher des truites à la main dans les ruisseaux et à piéger les oisillons avec des bâtonnets enduits de glu.
Avec l’insouciance de la jeunesse, qui ne pense à rien d’autre qu’à l’amusement, je considérais l’instruction comme une servitude réservée aux riches, servitude à laquelle j’avais le bonheur d’échapper puisque je n’appartenais point à leur caste et je m’en réjouissais. L’exemple de mes parents, qui vivaient tant bien que mal malgré leur ignorance, à l’instar de tous ceux que j’approchais, m’apparaissait comme le seul valable pour moi, et je n’avais d’autre ambition que celle de leur ressembler.
Si les amusettes, en compagnie des garçons de mon acabit, comptaient pour moi plus que l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, le plus clair de mes journées s’écoulait toutefois dans l’atelier de mon père et, au sortir de l’adolescence, j’étais devenu un bon ouvrier. Je n’avais pas encore acquis, certes, toute la science d’un maître cordonnier, mais j’étais déjà en mesure d’accomplir les travaux les plus divers et même d’achever quelques opérations délicates.
Mon père ne se privait point d’user de mes intéressantes dispositions, et lorsqu’il était surchargé d’ouvrage, il était bien aise d’avoir le secours de mes bras. Il avait surtout une clientèle de pauvres qui tardaient souvent à payer leur dû, pour des réparations de chaussures usées jusqu’à la corde, mais parfois certains bourgeois du lieu lui commandaient aussi des souliers neufs. C’était le cas de Simon Roux, vieil avocat bourru, de Jean-Pierre Melleret, médecin, de Pierre Robert, notaire, ou encore de noble Alexandre Dupont. Ce dernier était une manière de petit seigneur de village, portant avec beaucoup d’ostentation son titre de comte et affectant de traiter le menu peuple avec une condescendance aimable. S’il entretenait avec ses inférieurs des rapports dénués d’un mépris trop affiché, il usait toutefois de ses privilèges sans aucune retenue et n’oubliait pas de s’en prévaloir pour obtenir quelque avantage.
Pourtant respectueux de l’ordre établi, mon père maugréait souvent à l’encontre de ce personnage et de ses semblables, disant tout bas que « ces gens-là nous suçaient le sang et seraient la cause de grands désordres s’ils ne se rangeaient pas du côté des plus démunis qui trimaient sans rime ni raison pour que les riches soient toujours plus riches… »
Il avait de sourdes colères et de brusques emportements quand nous avions grand mal à joindre les deux bouts, malgré la somme de labeur qui était notre lot quotidien, notamment lorsqu’il lui fallait s’acquitter de la taille et de la capitation. À ces impôts royaux s’ajoutait la gabelle, mais aussi les octrois et péages lors de nos achats de produits divers à Romans et Valence, les charges indirectes prélevées sur toutes les opérations de quelque nature que ce fût et, une fois l’an, les rentes foncières ou « censes réelles ». Bien maigre était le reliquat de notre avoir quand nous avions subi toutes ces ponctions et le peu qui nous restait servait avant tout à la nourriture, puis à l’habillement. Ma mère fit en sorte, toutefois, pour que nous eussions toujours des vêtements décents et que mon père pût se rendre à l’auberge, le dimanche, sans avoir l’air d’un gueux.
La demi-douzaine de cabarets d’Étoile était le lieu de rencontre obligé où se retrouvaient les hommes après les parties de « cabra » sur la place du lavoir qu’entouraient de beaux platanes.
Mon père fréquentait tour à tour les deux ou trois estaminets les plus bruyants et les plus animés qui accueillaient la majorité de ses confrères cordonniers, les représentants d’autres corporations telles que celles des boulangers, des menuisiers, des serruriers, des tisseurs et fabricants d’étoffes, des ménagers et vignerons, des laboureurs, etc. auxquels se mêlaient aussi quelques négociants et petits bourgeois.
Tout ce beau monde portait « l’habit du dimanche » : bas de coton et jarretière, culotte de droguet marron, gilet de couleur voyante avec par-dessus la longue veste boutonnée descendant jusqu’à mi-cuisse, clabard à larges bords relevés sur trois côtés comme un tricorne. Les plus fortunés avaient des bottes ou, autour des jambes, des fourreaux en cuir appelés « garnaches ». Les travailleurs de terre, comme notre voisin et ami Jean Lérisse, étaient vêtus plus sobrement et se contentaient souvent, à la place de la veste, d’un sarrau en étoffe de grosse ratine.
Pendant que les adultes buvaient force verres du petit vin clairet que l’on produit dans la proche campagne, en échangeant les nouvelles et en les commentant à leur manière, les enfants jouaient librement dans les cours et les ruelles, à bêche-couri, au cheval-fondu, à la course à la bougie ou à la corde à l’eau.
Le bourg d’Étoile est un merveilleux village pour les jeux de toutes sortes. Bâti sur le versant d’un coteau à forte pente, entouré de murailles que les siècles n’ont point trop offensées, arrosé par les eaux abondantes de la Véoure et des ruisseaux d’Arcette et d’Ozon, jalonné de belles fontaines dont les habitants sont fort orgueilleux, paré de quelques maisons patriciennes à la sobre architecture, comme celle du comte Dupont, il possède tout un lacis de rues étroites s’entrecroisant sous de sombres voûtes, favorables aux cachettes et aux disparitions soudaines. Ces passages, ménagés avec un art consommé du mystère, au bas d’escaliers singuliers ou au fond de placettes secrètes, conduisent tout naturellement jusqu’au sommet de la colline qui porte, comme une triste couronne, les restes délabrés du puissant château des comtes de Valentinois où vécut, paraît-il, en sa jeunesse, la belle et célèbre Diane de Poitiers.
Il n’y a plus, auprès des murs écroulés et du donjon à demi ruiné, qu’un vaste jardin bien entretenu, avec de beaux massifs de fleurs, des treilles et de hautes frondaisons.
Ce parc, placé sous la protection de la communauté d’Étoile, servait à la fois de promenade, de lieu de repos et de divertissement pour les habitants du village. On y célébrait la fête des Laboureurs, le 22 janvier, la Chandeleur, la Mi-Carême et, le 23 juin, on y dansait et sautait autour du feu de la Saint-Jean.
Il accueillait aussi les rondes et les farandoles les plus folles, au son des violons et des clarinettes, à l’occasion de noces ou de charivaris. Bien que n’étant alors qu’un enfant de neuf ans, je me souviens du mariage de notre ami, Jean Lérisse, le 6 août 1782, avec Claudine Lioux, qui réunit sous les frais ombrages du parc les meilleurs danseurs de rigodon de toute la contrée.
Jean Lérisse, originaire de Chabeuil, était veuf en premières noces de Marie Françon. Mais, jeune encore et plein d’allant, il n’avait su se déterminer à rester seul et s’était résolu à convoler avec une jolie personne du sexe bien décidée à lui faire oublier la défunte et à partager les difficultés de la vie commune.
Et cette vie commune, si elle était heureuse et marquée par un amour réciproque, n’était qu’une suite ininterrompue de soucis de toutes natures. La condition médiocre de travailleur de terre ne rapportait que le strict nécessaire pour ne point mourir de faim et n’avait rien de comparable avec celle de cordonnier, pourtant loin d’être une sinécure !
Jean Lérisse, qu’accablait la cense personnelle, le vingtain, la cense aratoire, la dîme, et qui était astreint, de plus, aux banalités ordinaires et à deux ou trois journées de corvées « d’homme » ou de « bête de labour », n’était pas enclin à se plaindre, comme beaucoup d’autres, de son état, mais il n’en discourait pas moins avec véhémence sur les malheurs continuels qui frappaient le pauvre monde et sur la manière de les éviter.
Avec mon père, au milieu des fieffés buveurs qui se pressaient au cabaret et qui, dans l’ensemble, partageaient ses convictions, il recherchait des remèdes à la misère et proposait des réformes. Sans émettre une véritable opposition aux exigences fiscales du pouvoir royal, il en contestait l’application autoritaire et injuste. Il était loin, toutefois, d’être un trublion, et ne prêchait jamais la révolte.
D’autres, par contre, que le vin et les discours avaient échauffés plus que de raison, oubliaient toute retenue, et se lançaient dans de dangereuses diatribes, proférant même des menaces à l’encontre des autorités de la province, de la nation toute entière.
Pendant le fatal hiver 1788-89, dont la cruauté fut extrême et qui affecta les pauvres au-delà de ce qu’ils pouvaient endurer, les récriminations de tous ces furieux se firent encore plus virulentes et plus inquiétantes, reprises en cœur — avec moins de hargne mais tout autant de zèle — par une grande partie de la population que la famine exaspérait.
Avec la disette, d’autres fléaux s’abattirent sur Étoile. La Véoure, gonflée par de grosses pluies d’orage, rompit ses digues, détruisit des maisons isolées et se répandit dans les bas-prés, jusqu’à La Paillasse. Bien que l’intendant Caze de la Bove, alerté par les échevins, eût promis les secours nécessaires aux réparations, rien ne vint, et la communauté dut supporter seule le coût excessif des travaux.
Pendant que les habitants, dans l’eau glacée et bourbeuse jusqu’à mi-cuisse, s’échinaient à placer des fascines et des gabions, un flot inhabituel de va-nu-pieds, de mendiants, de bohémiens, de déserteurs, s’écoulait chaque jour à travers le village, s’introduisait dans les logis désertés et pillait ce qui pouvait l’être encore.
Le froid était si intense que les rivières et les fleuves étaient pris par les glaces. Des voyageurs contaient que des voitures chargées passaient le Rhône à Montélimar et que, de même, l’on traversait l’Isère à pied sec, d’une rive à l’autre.
Le gel avait détruit en partie les noyers, les châtaigniers, les mûriers, les figuiers, les vignes et les plantations encore en terre. Les greniers étaient vides de tout grain, et chaque ville conservait pour elle seule ses maigres réserves de blé, défendant qu’on en expédiât à des communautés qui n’en avaient plus.
À Étoile, les échevins avaient eu la sagesse exemplaire de créer un « grenier public », rue du Monétier, qui renfermait le grain acheté aux propriétaires du village, dix-huit livres le setier pour le blé et quatorze livres pour le seigle. Le dénommé Barthélémy Charignon avait été nommé garde du magasin, avec charge de distribuer cette manne sur le vu d’un certificat délivré par l’un des échevins.
En l’occurrence, le corps communal composé de notables aisés, comme Antoine Melleret, avocat, ou Pierre Robert, notaire, avait été d’une extrême sollicitude pour ses administrés, et, bien qu’un quarteron de grincheux — comme il y en a toujours — l’eût accusé de tirer profit de la situation pour s’enrichir, il essayait de mettre en œuvre une certaine théorie égalitaire dont on nous rebattait les oreilles depuis l’Assemblée des Trois Ordres de la Province, à Vizille près de Grenoble, en juillet 1788, puis la réunion des États du Dauphiné qui lui avait succédé et s’était tenue à Romans au début des grands froids.
Malgré la misère, qui ne cessait de croître avec la famine, la maladie et le chômage, malgré les errants toujours plus nombreux et qui s’organisaient en bandes menaçantes, malgré les débordements maladroits d’un pouvoir confronté aux malheurs du temps, une grande espérance venait de naître après qu’on nous eut assuré, sur tous les tons, des favorables dispositions prises au cours de ces deux Assemblées.
Cette espérance était double depuis qu’on avait eu connaissance, fin janvier 1789, de la convocation des États Généraux du royaume, à Versailles. Notre souverain, dans son infinie bonté, s’était déterminé à rassembler les députés des Trois Ordres, « autour de sa demeure, non pour gêner en aucune manière leurs délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d’ami ».
J’étais présent, à l’église, quand le curé Chaix, à la fin de la messe dominicale, nous lut en chaire la lettre qu’adressait Louis XVI à tous les Français. Sans en saisir toutes les subtilités, je compris parfaitement ce qu’elle annonçait, ce qui était pour nous tous une bonne nouvelle, l’assurance d’exposer librement nos revendications, l’occasion d’obtenir sans doute plus de justice devant l’impôt et, comme mes concitoyens rassemblés dans le sanctuaire, je ressentis une joie vive et profonde.
Quoique encore en pleine adolescence, et plus intéressé par l’attrayante découverte des différences intimes séparant les filles des garçons que par les bouleversements liés à la politique, je ne méconnaissais point l’étendue des droits seigneuriaux dont nous souffrions, j’en étais mal content comme tout un chacun, et je voyais d’un œil favorable s’ouvrir une brèche dans le mur des privilèges.
À la fin du mois de juillet 1789, parvint à Étoile une stupéfiante nouvelle, par le canal des gazettes arrivées à Valence, que le peuple de Paris s’était révolté, avait pris les armes et s’était emparé d’une vieille et for-midable prison royale, la Bastille, symbole même de l’oppression inique et de l’injustice.
Tout le village applaudit comme un seul homme à ce succès qui en préfigurait sans doute d’autres plus importants encore. Mais le curé Charles-François Chaix, élu depuis peu premier échevin, calma soudain la liesse populaire en rappelant avec force, au cours d’une séance publique, la situation critique du royaume, le délabrement des finances, la multiplication des « ennemis de l’État qui environnent le trône et en ferment l’accès à tout bon Français », et le danger de tout ce qui « pourra être fait contre le bien et les droits de la Nation ».
La majorité des assistants, frappée par la gravité de son discours, s’écria qu’elle sacrifierait « pour la majesté du trône et la liberté de la patrie, tant collectivement qu’individuellement, ses biens mais encore sa vie ». Et chacun jura « sur l’autel de la paroisse » qu’il demeurerait « inébranlablement attaché et fidèle aux principes de l’honneur, au Roy et au vrai patriotisme ».
On put vérifier, quelques jours plus tard, que les protestations de dévouement n’étaient pas lettre morte et que les gens d’Étoile ne resteraient point passifs devant le danger. Au bruit qui courut, en effet, que quatre mille brigands s’étaient répandus en Dauphiné où ils brûlaient les blés et empoisonnaient les puits, qu’une armée piémontaise avait franchi les cols des Alpes et envahi la province, qu’un « complot aristocratique » étendait ses perfides ramifications dans toutes les communautés de quelque importance, plus de trois cents citoyens du village, tous du tiers-état, s’assemblèrent dans l’église des Pénitents, à huit heures du matin, et décidèrent à l’unanimité la création d’une milice bourgeoise permanente, divisée en quatre compagnies, où ne seraient point admis les « individus pris de vin » et les mauvais sujets. Antoine Melleret et Jean-Antoine Sayn, bourgeois, furent nommés respectivement colonel et lieutenant-colonel par l’ensemble des participants qu’unissait une égale ferveur.
Mon père, désigné comme caporal, était inscrit dans le registre sous le numéro 127. Quant à Jean-Louis Sausse, ami de mon père, simple fusilier, il portait le numéro 115. Tous deux, quoique n’étant pas belliqueux par nature et n’ayant aucune aptitude particulière pour l’usage des armes, faisaient montre d’une volonté peu commune et, au contact de leurs compagnons pareillement enfiévrés, s’enhardissaient jusqu’à clamer la destruction prochaine d’un ennemi qui était partout mais qu’on ne voyait jamais !
J’étais moi-même fortement impressionné par leur détermination et leur courage, et j’applaudissais sans réserve à leurs guerrières intentions. J’eusse voulu partager avec eux les dangers dont on nous menaçait, et je rageais de ne pouvoir être encore qu’un spectateur. Avec mes frères et toute une ribambelle d’enfants et de jeunes écervelés de mon espèce, nous assistions aux évolutions maladroites de nos miliciens dont le semblant d’uniforme nous éblouissait et nous rêvions d’égaler leurs futurs exploits.
Ces prouesses, en réalité, se résumèrent en de longues factions aux portes du village, en de déplaisantes rondes nocturnes à travers la cité par petites escouades qu’éclairait un falot tremblotant, en d’infructueuses incursions dans la campagne jusqu’au bois de Perroton ou des Beaugros, à la recherche de ces insaisissables brigands que l’on avait aperçus près du pont de la Drôme, à Livron, dans la plaine de Chabeuil, sur les hauteurs de Mirmande, ou encore du côté de Romans…
Quand on eut pris conscience que toutes ces alarmes ne provenaient que de sots bavardages et que les épouvantables périls dont on nous menaçait n’étaient que les fruits gâtés d’une peur imaginaire, la milice bourgeoise — appelée bientôt garde nationale — cessa de courir par monts et par vaux et limita son action à quelques exercices et parades de prestige, comme celle où l’on bénit son drapeau, « don de la communauté à la jeunesse », qui portait en lettres brodées : « Mort ou Liberté ».
Les bourgs voisins, de même, avaient créé une garde nationale qui entretenait les meilleurs rapports avec celle d’Étoile. Antoine Melleret, honorablement connu dans toute la région, recevait ou visitait les chefs de corps de Beaumont, La Vache , Loriol, et était l’objet de la considé-ration de tous ces officiers improvisés.
On affirme aujourd’hui qu’Étoile doit à sa seule notoriété et à l’influence de sa famille, l’organisation du fameux rassemblement des gar-des nationales qui fut, dit-on, la première Fédération provinciale de ce type.
J’ignore s’il fut véritablement l’instigateur et le responsable de cette manifestation considérable, mais toujours est-il qu’elle eut lieu le 29 novembre 1789, à deux heures de l’après-midi, dans la vaste plaine que longe la grande route de Lyon à Marseille, à proximité du hameau de La Paillasse.
Ce jour-là, mon père était si excité par l’événement qui se préparait, qu’il ne put avaler que deux bouchées de pain, et qu’il me querella même pour que je fusse prêt à temps, car je l’accompagnais. Il avait astiqué lui-même son vieux fusil, son ceinturon et ses guêtres, et ma mère s’était appliquée à préparer soigneusement son habit bleu-roi à collet blanc.
Les quatre compagnies de la milice d’Étoile étaient en train de se ranger en bon ordre devant l’église, malgré l’effervescence qui les agitait, quand nous arrivâmes. Il était à peine midi et l’on battait la caisse pour appeler les retardataires. Mon père prit sa place, en tête d’une file, et je rejoignis à l’arrière le groupe confus et bruyant des garçons de mon âge que leurs pères avaient requis pour cette mémorable circonstance.
Au commandement d’Antoine Melleret, le porte-drapeau brandit son étendard et la troupe s’ébranla dans un ensemble qui, s’il n’était pas parfait avait au moins le mérite de ressembler à un mâle exercice.
Nous franchîmes la porte principale du bourg et descendîmes à pas pressés vers La Paillasse. Au pied du coteau, où se joignait à notre che-min celui venant de La Vache et de Montéléger, nous reçûmes le renfort de la milice de ces proches villages, et nous marchâmes de conserve, dans un bel enthousiasme, jusqu’au lieu qui avait été choisi pour recevoir les fédérés et qui n’était qu’un long rectangle de terre encore en friche délimité par une rangée de peupliers.
Au centre de ce champ inculte et caillouteux, l’on avait dressé une estrade flanquée à ses angles de hautes perches portant des oriflammes, autour de laquelle venaient se ranger tour à tour les forces armées des différentes cités.
Certaines, qui avaient dû parcourir plusieurs lieues, étaient déjà en place depuis la fin de la matinée, festoyaient avec les provisions de bouche qu’elles avaient apportées et trinquaient bruyamment lorsque appa-raissaient de nouveaux arrivants.
Nous fûmes ainsi accueillis avec force vivats quand l’un des commissaires nous conduisit à l’endroit qui nous était dévolu, à proximité de la tribune et à côté de la « milice nationale et citoyenne de Valence ». Celle-ci était remarquable par le nombre important de ses hommes et par la belle ordonnance de ses uniformes : « habit de drap écarlate ; doublure, revers et parements blancs ; collet bleu de roi ; veste, culotte et guêtres blanches ; houppes de différentes couleurs au chapeau, selon les compagnies … ».
Mais la plupart des gardes nationales, comme la nôtre d’ailleurs, qui n’avaient pas l’avantage de compter dans leurs rangs des gens aussi riches que les bourgeois de Valence, avaient une apparence beaucoup plus modeste quoique tout autant martiale et décidée. C’était à la fois une assemblée de Dauphinois massifs, trapus, frondeurs, et de Languedociens à l’œil sombre, noirs de peau, vifs et hâbleurs, car les miliciens de La Voulte en Vivarais, du Pouzin, de Beauchastel et de Charmes avaient franchi le Rhône, oublié pour un temps les différences d’accent, de langage, de coutumes, qui nous séparaient, et partageaient sans réserve notre allégresse.
Il y avait là, serrés au coude à coude sur cette morne étendue que couvrait un ciel d’automne où brillait un pâle soleil, presque blanc, plusieurs milliers de participants, solidaires, fervents, joyeux, écoutant avec une attention soutenue les paroles des orateurs qui se succédaient sur l’estrade et les accompagnant de leurs acclamations.
Jamais, de ma vie, je n’avais vu autant d’hommes réunis ensemble, jamais je n’avais été mêlé à une foule aussi abondante, aussi unie dans ses élans et ses effusions, et je me croyais transporté dans un monde imaginaire où seule régnait la concorde.
Les mots de fraternité, d’égalité, de liberté, prononcés à maintes reprises par Ducluseau de Chabreuil, colonel du régiment de La Voulte, chevalier de Saint-Louis, puis par Barthélémy Faujas de Saint-Fond, inspecteur des gardes nationales de Loriol, Livron, Cliousclat (des murmures respectueux accueillirent ce notable qui était, appris-je plus tard, un savant connu dans toute la France pour ses travaux de géologue, et qui occupait l’importante fonction de commissaire royal pour les mines et carrières ), résonnaient à mes oreilles comme une envoûtante musique dont je ne pouvais me défaire et qui me pénétrait tout entier.
À l’image de mon père, de Jean Lérisse, des compagnons de mon âge, de tous ceux qui vivaient cet instant mémorable, j’oubliais les misères du temps, la dureté de notre existence, les rigueurs imprévisibles des saisons. Je ne sentais plus ni la fatigue de demeurer sur place debout et im-mobile pendant des heures, ni les crocs acérés de la bise qui mordait toute la plaine avec une impitoyable constance. J’étais pleinement convaincu que l’ère nouvelle en train de naître chasserait tous nos malheurs et, quand le moment solennel fut venu pour tous ces fédérés de prêter « le serment d’union et d’alliance » qui terminait la cérémonie, je me mis à répéter après eux ces phrases passionnées que les ans n’ont point effacées de ma mémoire :
« Nous, citoyens français de l’une et l’autre rive du Rhône, depuis Valence jusqu’au Pouzin, réunis fraternellement pour le bien de la cause commune, jurons à la face du Ciel, sur nos cœurs et sur ces armes consacrées à la défense de l’État, de rester à jamais unis, abjurant désormais toute distinction de province, offrant nos bras, notre fortune et notre vie à la Patrie et au soutien des lois émanées de l’Assemblée nationale ; jurons d’être fidèles au Monarque qui a tant de droits à notre amour ; jurons de nous donner mutuellement assistance pour remplir des devoirs aussi sacrés, et de voler au secours de nos frères de Paris ou de toutes autres villes de France qui seraient en danger pour la cause de la liberté… »
La bataille des pyramides (extrait du chapitre VIII) :
Nous marchâmes d’une seule traite pendant plus de seize heures, écrasés de fatigue, pour parcourir les quinze lieues qui nous séparaient de Damanhour. Cette ville assez grande, entourée de palmiers, d’acacias, et où l’eau coulait en abondance, nous apparut comme le paradis terrestre, d’autant plus que les soldats de Desaix y avaient rassemblé des vivres et préparé les bivouacs. L’armée, ayant recouvré le moral, s’y refit une santé pendant deux journées réparatrices, puis leva le camp pour gagner El-Rahmânieh, au bord du Nil.
Ce fleuve, qu’on nous avait décrit comme l’un des plus puissants du monde connu, était d’une largeur inhabituelle, le double peut-être de celle du Rhône que je croyais pourtant incomparable. Nous le considérâmes d’un œil respectueux, assis à l’ombre de hauts sycomores qui prospéraient le long de ses berges limoneuses, puis, ayant eu la permission de nous y tremper, nous nous dévêtîmes et nous nous précipitâmes comme un seul homme dans ses eaux tièdes pour un bain salutaire.
Nous partîmes d’El-Rahmânieh le 24 messidor (12 juillet) à quatre heures du soir, après nous être gavés de figues et surtout de citrouilles ou melons d’eau qui nous occasionnèrent par la suite de fréquents maux de ventre. Nous dormîmes la moitié de la nuit aux abords du petit village d’El-Negyleh d’où l’on nous ordonna, avant l’aube, de faire mouvement vers Chobrakhyt. Il y avait, en effet, dans les environs de cette localité, une armée de cavaliers mamelouks, commandée par l’un de leurs souverains, Mourad-Bey, qui voulait nous interdire le passage. L’ennemi avait aussi, sur le Nil, plusieurs batteries et une flottille de petits bateaux qui attaqua d’ailleurs très vigoureusement les trois chaloupes canonnières, le chébec et la demi-galère nous accompagnant sur le fleuve sous les ordres du citoyen Perrée, chef de division de la marine.
Le combat, au fil de l’eau, fut d’une violence extrême et longtemps indécis. Les Turcs réussirent tout d’abord à prendre pied sur nos bâtiments, après un abordage des plus opiniâtres, mais Perrée, malgré une blessure au bras, parvint à redresser une situation très délicate et à la retourner totalement en notre faveur. Il y avait, paraît-il, sur le chébec, plusieurs civils embarqués qui firent le coup de feu avec beaucoup de courage, dont parmi eux les deux plus célèbres « savants » de l’expédition : Monge et Berthollet.
Les cinq divisions de l’armée, avec leurs bagages au centre et l’artillerie dans les intervalles des bataillons, s’échelonnaient dans la plaine, le long du rivage d’où nous suivions toutes les péripéties de la bataille navale. Quand elle fut terminée, à notre complet avantage, la masse compacte de la cavalerie mamelouk, groupée en amont à un quart de lieue, s’ébranla soudain et fondit sur nous.
Mais notre première rencontre avec ces farouches guerriers, parés de vêtements rutilants où l’or scintillait, qui brandissaient des carabines anglaises et des cimeterres , se limita au feu roulant dont nous les saluâmes ; devant le mur infranchissable de nos carrés hérissés de baïonnettes, ils renoncèrent à charger et tournèrent bride, laissant toutefois sur le terrain une centaine de morts et de blessés.
Ces fougueux cavaliers, qui fuyaient devant nous, quoique d’une adresse particulière pour conduire leurs superbes montures, ne nous semblèrent point aussi redoutables qu’on nous les avait dépeints et nous brûlâmes de les affronter à nouveau, mais sans qu’ils se dérobassent. Cette occasion nous fut offerte, huit jours plus tard, après plusieurs étapes très éprouvantes où nous fûmes dévorés par des nuées de petites mouches noires et de moustiques, et où nous ne trouvâmes qu’une infime pitance dans les misérables villages que nous traversions. Le soleil brûlant, la soif, la faim et la fatigue, la vision accablante d’un désert dont on ne mesurait point les limites, l’accumulation d’efforts toujours répétés, nous déprimèrent au point de créer parmi nous un climat d’irritation et de mécontentement qui se fût transformé en révolte avouée si, le 2 thermidor (20 juillet), arrivés dans un lieu appelé Omm-Dynâr, nous n’eussions vu se découper dans le lointain, sombres dans la clarté brutale d’un ciel de feu, trois formidables élévations aux faces triangulaires. Un cri unanime courut dans tous les rangs des divisions :
– Les Pyramides ! Les Pyramides !
La découverte de ces monuments illustres, vieux de « quarante siècles », chassa sur-le-champ nos récriminations et estompa notre courroux. Nous nous mîmes à disserter sur la manière dont le peuple d’Égypte avait pu les construire, à ergoter sans fin sur leur destination et leur utilité, puis comme nous étions presque tous des ignares et que nous n’avions aucune réponse à nos questions, nous convînmes que le meilleur moyen d’en apprendre davantage serait de les visiter quand nous serions installés au Caire.

Nous n’étions plus qu’à cinq lieues de cette ville immense, peuplée d’un million d’habitants, pourvue d’innombrables mosquées, construite sur une sorte de terrasse dominant le fleuve, mais la rumeur publique, transmise de compagnie à compagnie, nous avertit qu’une armée de soixante mille hommes au moins, composée de Janissaires, de Mamelouks, d’Arabes à pied, de Bédouins à cheval, s’était retranchée avec quarante canons près du village d’Embâbeh, sur la rive gauche du Nil.
Le 3 thermidor an VI (21 juillet 1798), à deux heures après-midi, nous nous trouvâmes face à l’ennemi et pleins du désir d’en découdre malgré notre infériorité numérique.
Le « petit caporal » ordonna aussitôt aux généraux Desaix et Reynier de faire mouvement vers Embâbeh pour y pénétrer et s’y établir, mais ils furent chargés par un corps d’élite de Mamelouks. Ils lui permirent de s’approcher à moins de cinquante pas pour mieux le fusiller, et ils le décimèrent si bien par leur mitraille qu’il se retira en désordre.
Pendant ce temps, notre division ayant à sa gauche celle de Menou que commandait provisoirement le général Vial, s’avança sur les retranchements de Mourad-Bey. Ma colonne d’attaque, sous les ordres du valeureux général Rampon, s’élança avec la plus grande impétuosité à l’assaut du camp des Turcs d’où sortit au triple galop un essaim de cavaliers mamelouks. Nous nous arrêtâmes pour les affronter en carrés et ils nous entourèrent avec des cris perçants, soulevant un nuage de poussière jaunâtre. Nos canons, chargés à mitraille, que nous décrouvrîmes au moment où ils arrivaient sur nous, fauchèrent sans rémission la moitié d’entre eux. L’autre moitié, toujours aussi téméraire malgré ses pertes, s’acharna à nous sabrer, mais nos salves terribles en désarçonnèrent une partie et le reste reflua vers les bataillons du général Vial qui achevèrent de le détruire.
Nous enlevâmes ensuite à la baïonnette toutes les positions de l’ennemi qui, bien que renforcées par des pièces d’artillerie, tombèrent sans coup férir entre nos mains. Nous délogeâmes de derrière les retranchements les troupes barbares qui s’y étaient fortifiées et qui ne demandèrent pas leur reste pour s’enfuir en direction du fleuve où un bataillon de nos carabiniers en fit un affreux carnage. Beaucoup de ces malheureux se jetèrent dans le Nil pour rejoindre les bateaux qui les avaient transportés du Caire, mais ne sachant pas nager ou frappés par nos balles, ils coulèrent à pic.
Nous nous emparâmes de tous les canons des Turcs, de quatre cents chameaux chargés de bagages et de munitions, d’une infinité de couffins remplis de fruits secs, de gâteaux aux amandes, de confitures, et d’une grande quantité de tentes sous lesquelles les beys et les kâchefs avaient abandonné de riches tapis, des soieries, de la vaisselle en porcelaine, des armes damasquinées et même de petits sofas en bois de palissandre.
Toutes ces prises de guerre revinrent aux divisions qui avaient participé avec éclat à la bataille, appelée depuis « bataille des Pyramides », et contribué à cette retentissante victoire. La caisse de chaque demi-brigade bénéficia par ailleurs de la quote-part qu’on préleva sur les pièces d’or et les bijoux dont étaient pleines les poches des Mamelouks morts et que certains d’entre nous délestèrent sans dégoût, repêchant même à l’aide de leur baïonnette ceux qui flottaient dans les eaux du Nil avec leurs visages blêmes et leurs yeux hagards.
Je n’avais que répugnance à l’idée de détrousser des cadavres, même ceux de mes ennemis, et je me refusai d’accomplir une aussi basse besogne. J’eus tort sans doute de ne point m’y associer, car elle rapporta gros à ceux qui s’y livrèrent, et qui purent ainsi se payer quelques fantaisies quand nous fûmes dépourvus de tout…
